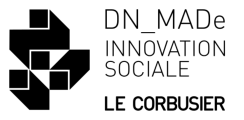Ce projet a été permis par “Les Utopiennes”, un recueil de nouvelles utopiques qui se déroulent en 2044. Ces nouvelles interrogent les changements profonds au sein de notre société et leurs conséquences positives comme négatives sur la vie des gens en 2044. La nouvelle “Terre de symbioses” raconte un futur où l’interdiction des pesticides a complètement modifié notre rapport au sol, “ici, on fait pousser le sol”.
Ce futur où la vie microbienne est remise au cœur de nos pratiques agricoles et alimentaires est-il souhaitable ?Nous avons voulu interroger nos camarades à ce propos. Mais comment les immerger dans cette utopie ? Comment pourront-iels se projeter dans ce futur abstrait qui n’est décrit qu’en quelques lignes ?
Pour redonner de la consistance et amener du concret à cette utopie, nous nous sommes lancé·e·s dans la création d’un dispositif expérientiel sous la forme d’une exposition. Nous avons commencé notre projet en nous interrogeant sur la manière de projeter l’utilisateurice dans le monde de 2044, suite aux modifications de la PAC (Politique Agricole Commune). En nous appuyant sur le texte fourni, nous avons identifié plusieurs points clés. Deux mots sont particulièrement revenus de façon récurrente : “Terre” et “Communauté”.
Ces notions nous ont guidé·e·s dans notre réflexion sur ce que nous souhaitions concevoir et présenter. Après une série de croquis d’objets et de concepts potentiels, deux idées ont particulièrement retenu notre attention et nous ont permis d’arrivés à ces deux provotypes:
- une micro-bonbonne de méthanisation, nommée Méthabonbonne;
- des maisons semi-enterrées, inspirées de l’architecture troglodytique, isolées naturellement par la terre, et intégrées dans un univers solarpunk.
Dans la suite du projet, nous avons sélectionné deux thématiques fortes du texte de départ pour les intégrer dans notre atelier : la lactofermentation et la production de biogaz domestique. L’idée de la méthabonbonne a été conservée comme élément central de notre proposition.
Après de nombreuses recherches sur le procédé de méthanisation, nous avons imaginé un dispositif simple et accessible : une méthabonbonne, un petit méthaniseur domestique qui pourrait être utilisé partout, même en milieu urbain. Son objectif est de permettre à chacun·e de produire son propre biogaz à partir de déchets alimentaires, et ainsi auto-alimenter sa maison en gaz.

Fonctionnement :
- L’utilisateurice insère ses déchets alimentaires dans la bonbonne.
- Un broyeur intégré permet de les réduire en matière plus facilement transformable.
- Le processus de méthanisation démarre automatiquement une fois la bonbonne refermée.
- Un écran numérique à l’avant affiche les données essentielles : température, taux de CO₂, volume de biogaz produit…
- À mesure que le biogaz se génère, un ballon de stockage se gonfle.
- Lorsque ce ballon est plein, une notification apparaît à l’écran et le biogaz est directement injecté dans le circuit de gaz domestique.
- Le résidu organique (ou digestat) peut être réutilisé comme engrais, aussi bien dans les potagers individuels que pour les champs communaux.

Ce dispositif répond à une logique de circularité énergétique et de réduction des déchets, tout en étant ancré dans une vision d’autonomie locale et écologique.
En parallèle, nous avons intégré une seconde thématique : la lactofermentation, un procédé ancestral de conservation, simple, sain, et économe en énergie. Plutôt que de simplement expliquer le processus, nous avons imaginé un lieu dédié : la LactoFabrique.
La LactoFabrique est une “usine collaborative” ouverte à toustes. Chacun·e peut venir y fabriquer ses propres produits lacto fermentés, à partir d’aliments issus du magasin communal (un lieu d’approvisionnement local regroupant les produits des fermes environnantes).
Les productions peuvent être destinées à une consommation personnelle, mais aussi à la cuisine collective, renforçant ainsi les liens entre habitant·e·s et leur autonomie alimentaire. Ce lieu devient alors bien plus qu’un espace de production : c’est un centre de transmission de savoir-faire, un outil de résilience communautaire, et un exemple concret d’économie circulaire.
À travers la méthabonbonne et la LactoFabrique, nous avons voulu imaginer un futur dans lequel les habitant·e·s de 2044 vivent en harmonie avec la nature, produisent leur énergie et leur alimentation localement, et participent activement à la vie de leur communauté. Ces projets s’inscrivent dans une esthétique solarpunk, où technologie douce, design organique et pratiques durables se rejoignent pour construire un monde plus résilient, plus juste et plus humain. Ces réalisations n’ont pas eu pour but de créer des produits de design fonctionnels mais bien de faire émerger chez les visiteureuses des réflexions quant au monde demain.
L’exposition

Arrivé·e·s dans l’ancienne mairie, une cuisine collaborative ouvre ses portes. Un travail d’équipe entre plusieurs personnes, la méthabonbonne au centre du projet et des produits lacto fermentés partout dans la cuisine. Une personne fait la cuisine et une autre coupe des légumes et met les épluchures dans la méthabonbonne. L’exposition ouvre ses portes, les gens découvrent notre cuisine, la vie en 2044, comment notre future est imaginé. Un guide de la cuisine collective présente le projet et explique la vie future.

Une fois imprégné·e·s de l’univers de Terre de symbioses, les visiteureuses ont été invité·e·s à participer à un débat mouvant afin de faire émerger une discussion riche. Le débat mouvant consiste à demander aux participant·e·s de prendre physiquement position en allant d’un côté ou de l’autre d’un espace définit comme étant pour ou contre. Les arguments formulés tentent de faire changer de « côté » l’autre camp s’iels sont convaincant·e·s. L’intérêt du débat mouvant réside dans la matérialisation physique du positionnement intellectuel et dans l’obligation de choisir un camp. Alors qu’il est impossible de connaître la position d’une personne silencieuse dans un débat « classique », le débat mouvant contraint chacun·e à donner son avis, au moins de façon non verbale. Il a donc été demandé aux visiteureuses si, ce futur qui remettait la vie microbienne au cœur des pratiques agricoles et alimentaires leur semblait souhaitable. Au début du débat, les participant.e.s étaient assez unanimes, ce futur leur semblait désirable. Néanmoins, des discussions ont commencé à émerger sur les angles morts de ce futur : l’alimentation lactofermentée devriendrait-elle obligatoire ? Qu’adviendrait-il des espaces urbains bien trop dépendants de l’agriculture productiviste ? Nous concluons donc que l’exposition et le débat ont su immerger les visiteureuses avec enthousiasme dans ce futur de symbioses où microbiotes terrestres et humains se lient pour faire communauté.
Réalisé par Ismaël Paillard, Léo Kohser, Sauvane Tavernier et Sarah Cosenza