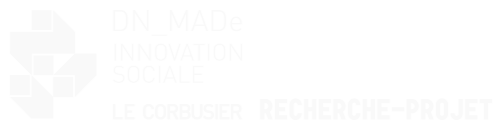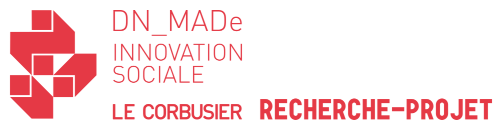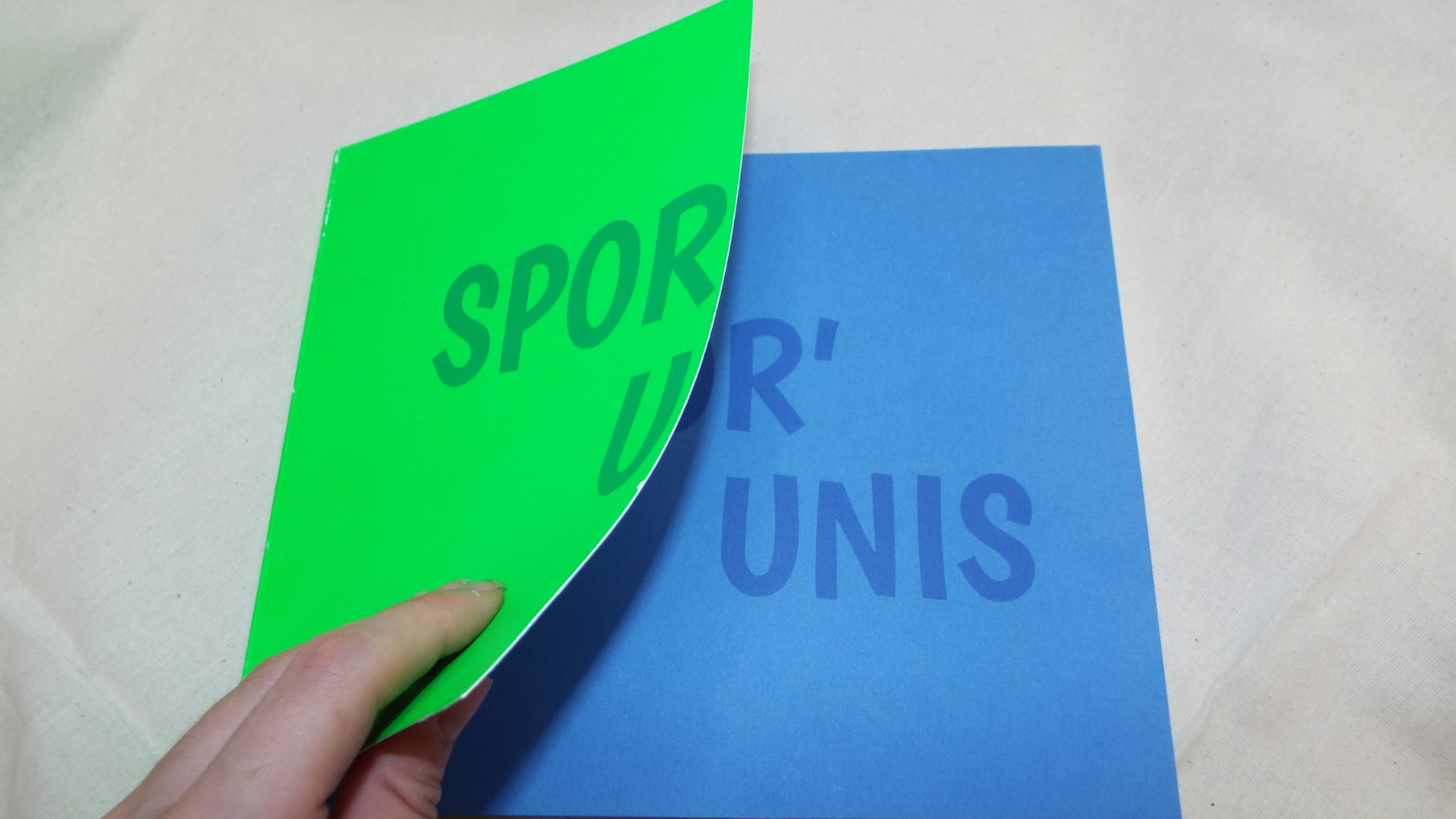Du terrain à la réflexion : repenser le sport comme lien social
« Le sport est un besoin humain fondamental », disait René Moustard. Pourtant, ce besoin universel reste loin d’être universellement satisfait. En France, il est profondément marqué par les inégalités sociales. Les plus favorisés cumulent les options – clubs, activités de plein air, infrastructures de qualité – tandis que, dans d’autres contextes, notamment dans les quartiers, le sport devient une affaire d’opportunités réduites, d’exclusion et de débrouille. Dans certains cas, il ne reste plus que le bitume au pied des immeubles. Et même là, il faut mériter sa place : avoir les codes, être le plus fort, le cousin de quelqu’un, sinon on se retrouve trop souvent sur le banc de touche. Le sport, censé rassembler, finit paradoxalement par diviser.C’est d’ailleurs ce décalage que j’ai voulu explorer.
Une expérience personnelle qui guide la réflexion
Ma pratique personnelle du sport a longtemps été solitaire : courir, pour m’évader, pour me recentrer. Mais au fil du temps, une évidence m’a frappée : et si le sport pouvait aussi (et surtout) créer du lien ? Et pourquoi ce lien est-il si inégalement réparti dans nos villes ? C’est ainsi que je suis arrivée à ma question de recherche : comment le design social peut-il agir concrètement pour rendre le sport plus accessible à toutes et tous ?
Mon mémoire part de cette réflexion intime, mais s’est nourri d’échanges de terrain avec des éducateurs, des jeunes, des associations d’éducation populaire comme la JSK à Koenigshoffen (Strasbourg). J’ai découvert la puissance du sport collectif comme espace d’appartenance, mais surtout les freins structurels qui empêchent beaucoup d’y accéder. Ces freins sont sociaux, culturels, parfois invisibles (manque de légitimité, manque d’autonomie, les licences, etc.), mais bien réels.
Des inégalités révélées en temps de crise
Ces inégalités ont été mises en lumière de manière encore plus forte pendant la pandémie de Covid-19. Lorsque les clubs ont fermé et que le besoin de bouger, d’être ensemble, s’est intensifié, nos espaces publics ont montré leurs limites : peu inclusifs, peu accueillants, rarement pensés pour inviter à la pratique libre et collective.
Quelque temps après, des initiatives institutionnelles ont émergé, comme le « design actif » promu dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Mais ces projets se sont souvent limités à des interventions dites « gadgets » : des poubelles en forme de panier de basket, du street art, des escaliers avec des messages culpabilisants sur les calories brûlées, qui nous invitent à marcher. Ces « nudges », censés encourager l’activité physique, restent déconnectés des réalités du terrain. Ils survolent les besoins profonds au lieu de les transformer.
Problématique et pistes de réflexion
Alors, avec tout cela, ma problématique a émergé, à la croisée du sport, de l’urbanisme et du design social :Comment le design social peut-il contribuer à transformer la pratique sportive dans les quartiers populaires, pour en faire un outil d’inclusion et d’épanouissement collectif ?
À l’aide d’études de cas, de nombreuses pistes ont émergé pour rendre le sport accessible : encourager l’autonomie, revaloriser les consignes lors des activités sportives, investir les espaces extérieurs en créant des parcours modulables et inter-quartiers, détourner le mobilier urbain pour lui donner une nouvelle fonction, et inventer des manières de pratiquer à plusieurs, autrement, tout en outillant ces pratiques etc…
Pour lire mon mémoire, cliquez ici